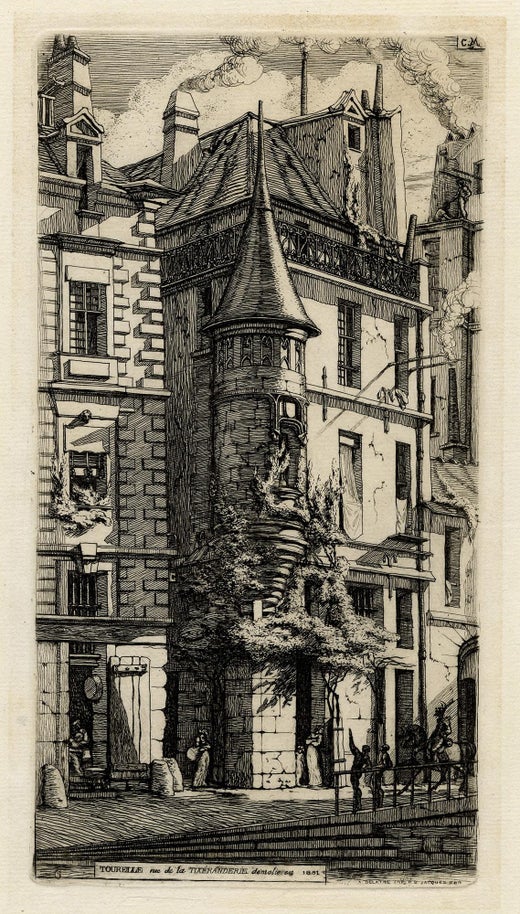Charles MeryonLe ministre de la Marine1865
1865
À propos de cet article
- Créateur:Charles Meryon (1821-1868, Français)
- Année de création:1865
- Dimensions:Hauteur : 17,78 cm (7 po)Largeur : 16,21 cm (6,38 po)
- Support:
- Période:
- État:
- Adresse de la galerie:New York, NY
- Numéro de référence:1stDibs : LU75233077551
Charles Meryon
Charles Méryon était un graveur, peintre, dessinateur et poète français. Il mène une vie aventureuse et voyage souvent en tant que Marin avant de se consacrer exclusivement à la gravure à partir de 1848. Il a gravé 72 planches sur Paris, dont certaines, comme Tour de l'Horloge, ont été publiées par l'importante revue parisienne L'Artiste. Il a réalisé principalement des architectures, des paysages marins, des scènes avec des sujets ornithologiques et quelques portraits. Ses estampes se caractérisent par un jeu rigoureux de lignes entrecroisées, par une précision digne d'un dessinateur naval, par un clair-obscur audacieux aux effets dramatiques et aux fantaisies romantiques. Il a souvent inclus des légendes de vers dans ses gravures.
Suggestions
années 1920, Impressionnisme, Estampes - Paysage
Pointe sèche, Eau-forte
années 1820, Victorien, Estampes - Paysage
Eau-forte, Intaille
XXIe siècle et contemporain, Expressionniste, Estampes - Paysage
Eau-forte
années 1980, Abstrait, Estampes - Paysage
Gravure, Eau-forte, Aquatinte
Début des années 2000, Estampes - Paysage
Aquatinte, Eau-forte
Début du 20ème siècle, Modernisme américain, Estampes - Paysage
Papier fait main, Eau-forte, Papier vergé
Début du 20ème siècle, Modernisme américain, Estampes - Paysage
Papier fait main, Eau-forte
années 1940, Modernisme américain, Estampes - Paysage
Papier fait main, Eau-forte
Début du 20ème siècle, Modernisme américain, Estampes - Paysage
Papier fait main, Papier vergé, Eau-forte
Début du 20ème siècle, Modernisme américain, Estampes - Paysage
Papier fait main, Eau-forte, Papier vergé